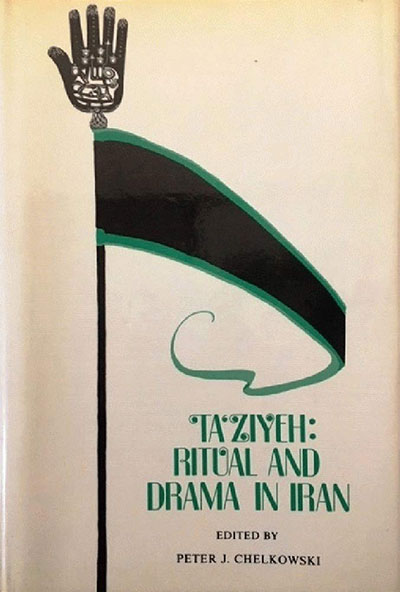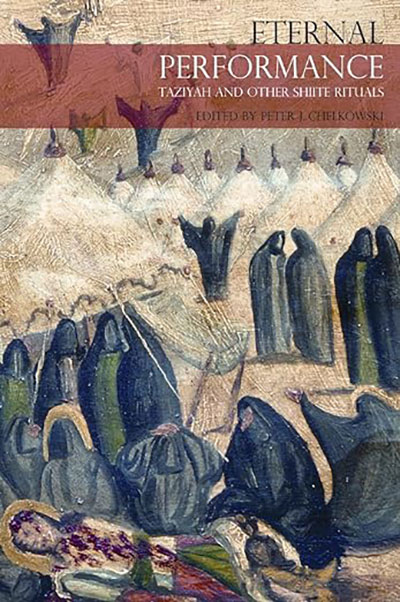Ashura
Célébration d’Ashura à Taft : des hommes portent le monumental cercueil symbolique de l’Imam Hossein. Photographie : ©Patrick Ringgenberg.
« J’ai vu dans un village iranien isolé l’une des choses les plus fortes auxquelles j’ai jamais assisté au théâtre : un groupe de 400 villageois, toute la population du lieu, assis sous les arbres et passant des éclats de rire aux sanglots complets – bien qu’ils connussent parfaitement la fin de l’histoire – lorsqu’ils voyaient Hossein risquant d’être tué, dupant ensuite ses ennemis, puis martyrisé. Et lorsqu’il fut martyrisé, la forme théâtrale devint vérité. »
Ce témoignage est de Peter Brook (1925-2022), homme de théâtre exceptionnel, qui assista dans les années 1960 à la représentation d’un théâtre typiquement iranien et chiite : le ta’ziyeh, c’est-à-dire la mise en scène rituelle et théâtralisée du martyre de Hossein, le troisième Imam des chiites.
À la mort du Prophète Muhammad en 632, les musulmans se divisent : une majorité de croyants élit Abu Bakr comme le premier calife, chef des musulmans et chef de prière, alors qu’une minorité, les « chiites », fait sécession, en affirmant que le vrai successeur du Prophète ne peut être qu’Ali, qui avait épousé la fille du Prophète, Fatima. Ali devint le quatrième des quatre califes des sunnites, après Abu Bakr, Omar et Uthman, mais il devint pour les chiites le premier des Imams, à la fois maître spirituel et héritier véridique de la Révélation musulmane. Fatima et Ali eurent deux fils, Hassan et Hossein, respectivement 2e et 3e Imam.

Un ta’ziyeh : le campement de l’Imam Hossein et des siens est brûlé par les soldats omeyyades (habillés en rouge). Photographie : ©Payam Moein (Wikimedia).

« Le soir d’Ashura » : une célèbre peinture de Mahmud Farshchian (1977), représentant les femmes éplorées autour du cheval de Hossein, revenu au camp sans son cavalier, mort. Source de l’image : ©Tehran Times.
En 680, Hossein est massacré avec ses compagnons à Kerbala (Irak) par une armée des Omeyyades, une dynastie arabe – la première du monde musulman – régnant depuis Damas. Pour les chiites, cette tragédie devint le symbole du martyre, du sacrifice de l’innocent pour une cause spirituelle. Très vite, la tombe de Hossein fut vénérée, et des processions organisées pour commémorer son martyre. Quelques siècles plus tard, à l’époque qajar (19e siècle) ou déjà même avant, les événements de Kerbala devinrent l’objet d’un théâtre sacré, analogue aux Passions chrétiennes que l’on peut encore voir en Espagne ou en Amérique du Sud. En plein air ou dans un lieu spécialement aménagé (le tekyeh), des comédiens en costumes restituent, dans un décor plus ou moins élaboré (tentes, animaux, palmiers, etc.), les derniers jours de la vie de Hossein et des siens, récitant des textes écrit à l’avance, dans une mise en scène plus ou moins élaborée. Dans le monde musulman, qui n’a pas développé d’art théâtral, les ta’ziyeh sont le seul théâtre typiquement islamique, profondément enraciné dans la culture et la spiritualité chiites, et qui n’est pas seulement une représentation : elle est la restitution rituelle d’une tragédie fondatrice pour la conscience chiite.
Les ta’ziyeh s’inscrivent dans un ensemble de commémorations se déroulant les dix premiers jours du mois arabe de muharram. Chaque jour des hommes défilent en procession, en se flagellant rituellement au rythme de percussions, ou en portant d’immenses bannières. Partout, on dresse des guérites, où l’on offre thé, sirop et pâtisseries aux gens. Le 10 du mois de muharram est l’Ashura : le jour du massacre de Kerbala. Ce jour, des hommes portent une immense structure en bois, le nakhl, qui symbolise le cercueil de Hossein. Le soir, les fidèles allument des bougies et les commémorations de muharram s’achèvent avec cette veillée funéraire.

Un porteur de bannière, lors d’une procession de muharram, à Téhéran. Photographie : ©Patrick Ringgenberg.
Pour qui voudrait vivre une expérience théâtrale et spirituelle intense, les commémorations de muharram et d’Ashura sont incontournables et inoubliables. Des célébrations se déroulent dans tout le pays (sauf en régions sunnites), mais certains lieux sont plus célèbres que d’autres, comme la ville de Yazd et les villages environnants. Comme la date de l’Ashura est déterminée par le calendrier arabe, les dates des commémorations sont mobiles dans l’année. En 2025, le 1-10 muharram correspondra au 27 juin-6 juillet ; en 2026, au 17-26 juin ; en 2027, au 7-16 juin ; etc.
Pour en savoir plus sur le ta’ziyeh, voici deux livres classiques (en anglais) et un documentaire de la télévision iranienne (en persan sous-titré en anglais) :